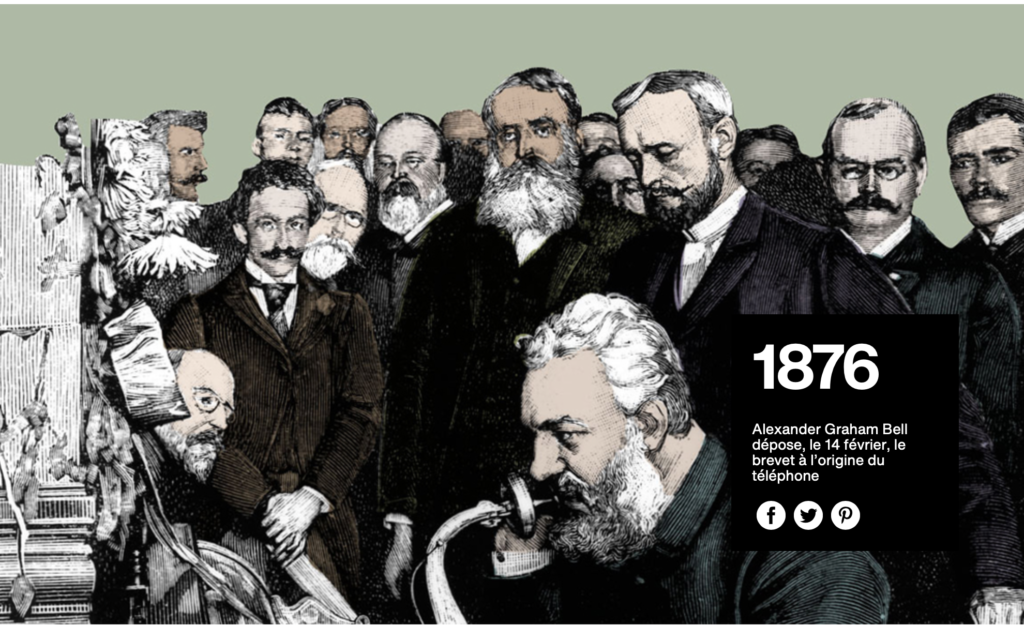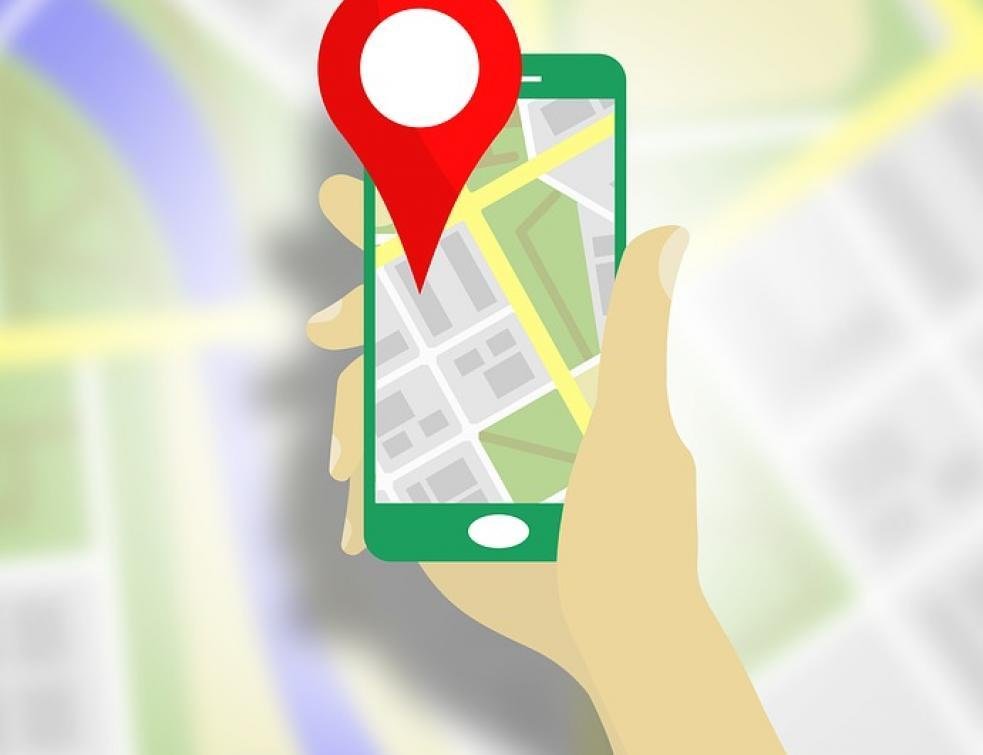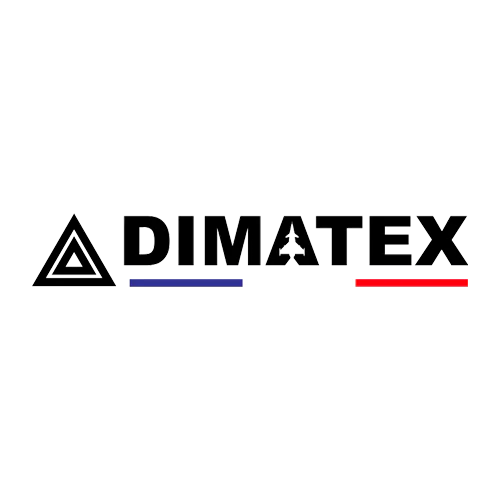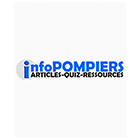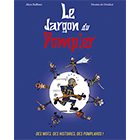Rescue 18 vous propose un article traitant des numéros d’appels d’urgence utilisés en France. De l’histoire de leur création à l’évolution de ces numéros de 2 à 3 chiffres, découvrez à travers ces quelques lignes la naissance des numéros d’urgence, évolution majeure de notre société dans l’alerte des différents services de secours.
Histoire des numéros d’urgence
Autrefois, les téléphones n’existaient pas ou peu et certaines villes ont équipé des lieux publics avec une borne d’appel, où il fallait briser la glace pour décrocher un combiné et ainsi être en contact direct avec la caserne du quartier sans passer par un standard.

Car avant les cadrans téléphoniques, c’est par les opératrices que l’on passait du téléphone au standard téléphonique pour joindre son interlocuteur. L’appel d’urgence était transmis au commissariat ou à la caserne la plus proche. Étant donné la rareté des téléphones, il était nécessaire de connaître le numéro local de la caserne ou du commissariat le plus proche, même si les communications ont été automatisées en 1928.
Avec le Plan de Numérotation des numéros de téléphone de 1953, les numéros en dizaine sont réservés aux numéros utilitaires : le “10“ pour la standardiste, le “11“ pour la messagerie vocale, le “12“ pour les informations, le “13“ pour le réveil et les dérangements, le “14“ pour le télégramme, le “15“ et le “16“ pour le changement de zone, le “17“ pour la Police ou la Gendarmerie, le “18“ pour les Sapeurs-Pompiers et le “19“ pour l’international.
Même s’il est fondé en 1968 à Toulouse, le Service d’Aide Médicale Urgente ne se voit attribuer le “15“ qu’à partir de 1978.
Histoire du “15“
En 1978, le “15“ est attribué au ministre de la Santé par le secrétaire d’État aux postes et télécommunications. C’est une victoire pour la Santé qui tentait depuis une dizaine d’années de faire de l’hôpital public le centre d’organisation des secours d’urgence. Le “15“ est alors le numéro des SAMU, c’est-à-dire un ensemble de moyens techniques et logistiques permettant la coordination des secours médicaux à partir de 1980.
Les centres 15 doivent répondre à toutes sortes d’appels : les appels de détresse des citoyens, les appels d’urgence des praticiens de garde, ainsi que les appels de médecins à la recherche de lits d’hospitalisation ou de produits manquants. Pour y répondre, des « permanents » sont formés en tant que standardistes et auxiliaires des médecins régulateurs. La réception de l’appel doit en effet permettre le déclenchement et l’envoi rapide d’une ambulance équipée, dans laquelle officie un médecin urgentiste.
Cependant, l’entrée du “15“ dans le paysage des secours est la résultante d’une lutte entre les services du ministère de la Santé et ceux de l’Intérieur, dont dépendent la police et les sapeurs-pompiers. Depuis l’entre-deux-guerres et jusqu’en 1980, les Français ont le choix entre composer le “17“ qui est reçu par les forces de l’ordre, le “18“ qui conduit aux pompiers, ou encore appeler un médecin ou un hôpital en composant un numéro dit « normal », à plusieurs chiffres et différents selon le lieu de l’urgence. Cette configuration est d’autant plus préjudiciable que le “17“ ou le “18“ ne permettent pas l’accès à des services médicaux. Certaines situations sont aussi graves que toute perte de temps a des conséquences importantes.
Cette question de la rapidité des secours devient encore plus pressante dans les années 1960 du fait de la croissance inquiétante du nombre et de la gravité des accidents de la route. Face à ce problème public, certains administrateurs du ministère de la Santé, assistés de médecins, tentent d’apporter des solutions et dénoncent “la concurrence“ de numéros d’urgence consacrés à des incidents domestiques de moindre gravité.
Dans le début des années 1960, René Coirier, le chef du bureau des secours d’urgence au ministère de la Santé, a rapporté de missions à l’étranger, des exemples de plusieurs initiatives qu’il souhaiterait voir en France quant à la gestion des appels d’urgence médicale. D’abord l’URSS, où depuis les années 1960, les services fonctionnent à partir de trois numéros : un numéro consacré aux urgences médicales, le “03“, un deuxième consacré aux incendies, le “02“, la police pouvant être contactée par le “01“. Les appels au “03“ sont reçus par un personnel spécialisé, composé d’infirmières et de médecins, et les équipes médicales interviennent depuis des stations d’urgence. Autre exemple également étudié, la Belgique. La population dispose d’un numéro d’appel unique pour l’ensemble des secours, le “900“, mis en service en 1959 à Anvers. Ces pays, relativement précoces, constituent deux modèles, le cas belge remettant en question l’idée d’une spécialisation de la réponse aux appels d’urgence.

Ce n’est qu’en 1976 que cet enjeu conduit à des discussions entre les services de la Santé et de l’Intérieur, sous l’égide des autres ministères. Le comité interministériel sur la sécurité routière, créé en 1970 pour améliorer la qualité des liaisons entre les acteurs des secours d’urgence, est à l’origine de ces négociations. La situation est, pour leur part, compliquée par les représentants du ministère de la Défense qui exigent l’octroi d’un nouveau numéro à deux chiffres pour la Gendarmerie, ce qui porterait à quatre le nombre de numéros. Cette requête n’est finalement pas considérée, car elle est jugée techniquement impossible à réaliser par les ingénieurs des télécommunications.
Il serait possible de communiquer un numéro d’appel urgence unique pour satisfaire les différents acteurs, selon le modèle belge. Les téléphonistes seraient chargés de recevoir les appels aux services les plus proches et de répondre à l’urgence. Le ministère de la Santé s’oppose à cette solution, qui irait à l’encontre du secret médical et qui serait surtout une source de retard dans l’engagement des secours.
Histoire du “17“
L’institution actuelle est créée par la loi no 66-492 du 9 juillet 1966, portant organisation de la police en France. Cette loi unifie alors les services de la Sûreté nationale et la préfecture de police. Le numéro d’appel d’urgence de la Police nationale est le “17“, qui est d’ailleurs partagé avec la Gendarmerie Nationale. Les appels au “17“ Police-Secours sont ainsi traités par l’une ou l’autre force de l’ordre en fonction de la localisation de l’appelant.
Alors que le numéro d’appel “17“ est introduit en 1930, c’est en 1928 que les premières bornes de police de secours font leur apparition à Paris. Elles étaient implantées tous les 500 m environ. Dans les années 1970, le développement du téléphone a entraîné leur disparition.

A l’époque, n’existent que les téléphones à cadran, et non pas à touches… En cas d’urgence, l’objectif est de passer l’alerte le plus rapidement possible ! Le 1 était au tout début du cadran, il suffisait donc de parcourir 2 centimètres avec son doigt pour composer ce chiffre. On peut alors se demander pourquoi ne pas avoir donné le “11“ comme numéro d’appel national à la Police ? Quand on a cherché un numéro d’appel identique dans la France entière pour joindre Police Secours, ou les Sapeurs Pompiers, sachant qu’avant, il fallait connaitre le numéro du commissariat ou de la caserne, on voulait évidemment deux numéros qui se suivent.

Or, le “11“ était bien disponible, mais le “12“ était déjà occupé, par les renseignements ! Juste derrière, le “13“ servait aux dérangements, et le “14“, à joindre les PTT, puis, France Telecom. Le “15“ était libre, mais le “16“ était pris pour les appels Paris-Province et Province-Paris ! Les deux seuls numéros courts libres et contigus étaient donc le “17“ et le “18“. Le “19“ était l’ancêtre du “00“, pour les appels internationaux. Ainsi, naissait le “17“ numéro d’appel des Forces de l’ordre.

Histoire du “18“
1892 est la date de l’adoption du téléphone dans les avertisseurs et les postes pour remplacer les appareils télégraphiques sur Paris. Cette innovation est une réelle plus-value pour le stationnaire qui possède la lourde responsabilité de dépêcher les secours. Il peut désormais obtenir de précieux renseignements comme l’adresse exacte du sinistre, sa nature, son importance et donc évaluer le volume de “voitures“ à faire partir.
En 1924, tous les centres de secours parisiens sont désormais reliés au téléphone urbain. En demandant les pompiers, l’appel est automatiquement transféré à l’état-major, qui, par l’intermédiaire des “lignes de feu“, retransmet l’alerte aux postes concernés.

En France, le numéro d’urgence pour les pompiers est le “18“. La France dispose d’un numéro dédié pour solliciter les sapeurs-pompiers, contrairement à d’autres pays, qui assure une intervention rapide et efficace en cas d’incendie ou d’autres urgences médicales, de part un maillage territorial exclusif. Cette approche unique permet d’éviter les confusions et de garantir le déploiement rapide des secours sur les lieux d’intervention.
C’est à partir de 1930 que les parisiens peuvent composer le “18“ pour alerter les sapeurs-pompiers. Toutefois, les sapeurs-pompiers recommandent alors de n’avoir recours au “18“ qu’en cas d’ignorance du numéro d’appel de la caserne concernée, et cela pour éviter toute perte de temps.
En 1972, quarante ans après la mise en service du “18“ dans la capitale, la réception est enfin centralisée grâce à la création du Centre de Coordination des Opérations et des Transmissions (CCOT), au sein de l’état-major des sapeurs-pompiers parisiens.
En 1981, l’arrivée de l’informatique à la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris donne réellement au “18“ toute son efficacité dans la procédure du déclenchement de l’alerte. Les logiciels utilisés se nomment successivement “SYCORA“ puis “SYNTIA“.
Au fil des ans, l’usage du téléphone se développe. Mais si, dans les grandes villes, l’appel au “18“ relie directement le requérant à la caserne, dans les petites bourgades, c’est à la mairie, chez le chef des pompiers ou encore à la Gendarmerie, qu’aboutit l’appel au “18“.
En France, l’alerte des pompiers s’est construite autour d’une histoire principalement communale avec des diversités et des inégalités flagrantes selon les territoires.
Histoire du “112“
Les numéros à 3 chiffres apparaissent au début des années 1990, le “112“ est assigné par le Conseil des Communautés Européennes (de la CEE) pour toutes les urgences à partir de 1991. Mais il faudra attendre la réforme de 1996 avec le passage des numéros de téléphone à 10 chiffres, pour que le “112“ apparaisse en France, ce qui a permis de réserver le “115“ pour le SAMU social, le “119“ Service National d’Accueil Téléphonique de l’Enfance en Danger, etc…
Créé en 1991 par le Conseil des communautés européennes, le “112“ est le numéro d’appel d’urgence européen unique, disponible gratuitement partout dans l’Union européenne. En France, le “112“ ne remplace pas les numéros d’urgence existants.
Si vous êtes impliqué dans un accident ou que vous en êtes témoin, ou si vous remarquez un incendie ou apercevez un cambriolage, vous pouvez appeler le “112“.
Ce numéro est joignable à partir :
- d’un téléphone fixe ;
- d’un téléphone portable ;
- d’une cabine téléphonique.
Il permet d’être en contact avec les services d’urgence appropriés.
Le numéro est gratuit et fonctionne 24/24h et 7 jours sur 7.
En 2011, l’État a proposé un numéro d’urgence pour les personnes sourdes ou muettes. Le numéro “114“ est attribué par l’ARCEP via le Centre National de Relais “114“ depuis le CHU de Grenoble.
Selon une décision de la Commission Européenne, les numéros d’urgence pour enfants sont classés en numéros “116 … » : enfants disparus (“116 000“), Enfance en danger (“116 111“, destiné à remplacer le “119“) et médecin de garde (“116 117“, en complément de l’actuel “3966“ pour les adultes).
En 2013, plusieurs numéros courts apparaissent : le “196“ pour les urgences en mer (à la place du “1616“), le “191“ pour les urgences en milieu aérien et le “197“ pour les urgences attentats (suite aux évènements de Toulouse et Montauban).
Et demain ?
Comme vous avez déjà pu le lire dans cet article, l’avènement de “NexSIS 18-112“ doit permettre une certaine interopérabilité entre les systèmes de l’ensemble de la chaîne de secours, tout en garantissant une meilleure résilience qui s’appuie sur un réseau commun de collecte des appels. Cette interopérabilité permettra le partage d’informations, grâce à un système de gestion des alertes multi-métiers (“112“) (Secours d’urgence, soins, sécurité publique…).
Le système vise à améliorer l’entraide entre SIS, notamment en cas de flux importants d’activités, de perte d’une plateforme de traitement, ou de besoin de renforts avec transmission automatique des données.
Les maires, les préfets, les Centres Opérationnels Départementaux (COD), les Centres Opérationnels de Zone (COZ) et le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises (COGIC) bénéficieront de la collaboration et d’un échange facilité de données grâce à la plateforme numérique “NexSIS 18-112“.
Les différents acteurs peuvent développer une vision partagée et instantanée de la situation opérationnelle grâce à la maîtrise de l’information et des flux de données (absence de double saisie des données par chaque acteur, amélioration du suivi des opérations…)
Conclusion
Dans un contexte sociétal de plus en plus complexe, il semble important et nécessaire de pouvoir mutualiser les moyens et compétences afin d’offrir aux requérants une réponse adaptée, rapide et efficiente et ainsi garantir une certaine résilience de notre société face aux aléas et risques de la vie quotidienne, qu’ils soient ordinaires ou extraordinaires.