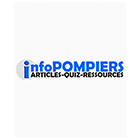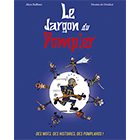Les accidents de la circulation touchent aussi les sapeurs‑pompiers, en intervention comme lors des trajets vers la caserne : en France, les études montrent que le risque routier reste une cause majeure de blessures et de décès dans la profession. On estime que les déplacements domicile‑caserne représentent entre 5 % et 10 % des accidents chez les sapeurs‑pompiers, proportion plus élevée chez les volontaires.
Connaître ses droits à indemnisation, préparer son dossier et adopter les bonnes pratiques sur le terrain et pendant les trajets sont essentiels pour préserver sa santé, sa carrière et obtenir une réparation juste.
Le Cabinet NP, en collaboration avec Rescue18, vous propose donc un éclairage sur ce sujet.
De quoi parle-t-on ?
Chaque année, plus de 230.000 personnes sont blessées dans des accidents de la route en France et plus de 3.000 personnes sont décédées (selon le bilan 2024 réalisé par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière). Souvent, les victimes, qu’elles soient conductrices ou non conductrices, peuvent prétendre à une indemnisation.
L’indemnisation n’est toutefois pas automatique et implique une vigilance accrue de la part de la victime à tous les stades de la procédure amiable ou judiciaire face aux compagnies d’assurance dont les intérêts sont purement financiers.
En effet, les intérêts des assureurs et des victimes sont divergents. Les assureurs ont tendance à contester le droit à indemnisation de la victime et à minimiser son dommage dans leur propre intérêt, à savoir payer le moins possible alors que la victime a droit à une juste réparation de son préjudice.
Les sapeurs-pompiers, lorsqu’ils sont eux-mêmes victimes, n’échappent ni à ces statistiques ni à la nécessité d’être particulièrement vigilants tout au long du processus d’indemnisation qui comporte de nombreux pièges à chaque étape.
Il faut donc être particulièrement vigilant et se poser les bonnes questions !
Ai-je droit à une indemnisation ?
Le cas des piétons, passagers d’un véhicule (voiture ou moto), cyclistes… : indemnisation intégrale
Ces victimes ont un droit à indemnisation intégrale sur le fondement de la Loi Badinter du 5 juillet 1985 et ce peu importe les circonstances de l’accident sauf en cas de faute inexcusable de la victime.
Le droit à réparation intégrale implique une réparation de toutes les conséquences de l’accident pour la victime. Ce principe a été posé par la 2e chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 1954 selon lequel « le propre de la réparation est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée, si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ».
Pour parvenir à cette réparation intégrale, la nomenclature Dintilhac liste de façon non exhaustive l’ensemble des postes de préjudice pouvant être indemnisés.
Cette nomenclature distingue les postes de préjudice patrimoniaux (frais médicaux, frais divers, pertes de revenus, assistance d’une tierce personne, frais d’aménagement du logement, frais d’aménagement du véhicule…) et extrapatrimoniaux (déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément…).
Le cas des conducteurs victimes non fautifs ou partiellement fautifs
Le conducteur d’une voiture, d’un deux roues ou d’un Engin de Déplacement Personnels Motorisé (EDPM) victime est aussi indemnisé sur le fondement de la Loi Badinter en l’absence de faute de conduite (indemnisation intégrale) ou si la faute a partiellement participé à la réalisation du dommage (limitation du droit à indemnisation évaluée en fonction de l’incidence de la faute, ex. partage 50/50).
Statistiquement, les motards sont beaucoup plus exposés aux accidents de la route. Ils sont souvent considérés comme responsables de l’accident (conduite à une vitesse excessive, dépassement dangereux en interfile, comportement inadapté …). Ces situations appellent une grande vigilance.
En effet, il ne suffit pas de dire que le motard roulait trop vite pour exclure ou limiter son droit à indemnisation. La faute doit être prouvée par celui qui entend l’opposer (notamment l’assureur) mais elle doit aussi avoir joué un rôle dans la réalisation de l’accident.
Le cas des conducteurs victimes entièrement fautifs ou ayant eu l’accident seuls
Dans ce cas, une indemnisation peut aussi être envisagée si le contrat d’assurance auto/moto contient une garantie dommage corporel du conducteur (le nom de cette garantie peut varier en fonction du contrat).
Chaque contrat d’assurance est différent et comporte des conditions propres de mise en œuvre des garanties : définition des garanties, exclusions de garantie, seuil d’intervention, plafond de garantie, postes de préjudice indemnisables…
ATTENTION :
- Une assurance « tous risques » n’implique pas automatiquement une couverture du conducteur en cas d’accident,
- Certains contrats ne prévoient que le versement d’un capital calculé au regard du taux d’invalidité,
- Le délai pour actionner son contrat est de 2 ans à compter de la date de consolidation de l’état médical de la victime.
Comment faire si le véhicule impliqué dans l’accident a pris la fuite ou n’est pas assuré ?
En principe, il appartient à l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident d’indemniser la victime de ses préjudices. Si le conducteur n’est pas retrouvé ou si le véhicule n’est pas assuré, le Fonds de Garantie des Assurances Automobiles prend le relai pour permettre à la victime (ou ses proches) d’être indemnisée.
ATTENTION, lorsque l’auteur de l’accident n’est pas identifié, la victime doit saisir le Fonds de Garantie dans un délai de 3 ans à partir de l’accident pour envisager une indemnisation.
Puis-je me rendre seul à une expertise médico-légale ?
Bien souvent, les victimes pensent pouvoir se rendre seules à une expertise. L’expertise médico-légale est une étape clé dans le processus indemnitaire sachant que le rapport d’expertise constitue la base de l’évaluation des préjudices de la victime.
Une expertise ça se prépare !
Avant de se rendre à une expertise, il faut réunir toutes les pièces pour permettre une évaluation de l’intégralité du dommage de la victime. Des bilans (médicaux, psychologiques, ergothérapiques, appareillages…) peuvent être réalisés par des spécialistes.
Durant l’expertise, il est important d’être accompagné d’un médecin conseil de victime et d’un avocat spécialisé pour faire contrepoids face à l’assureur et son médecin. L’objectif est de permettre une évaluation juste et complète de toutes les conséquences de l’accident pour la victime.
Le métier de sapeur-pompier est tant connu qu’inconnu. Bien souvent, on ignore les spécificités statutaires (militaire, professionnel, volontaire…) de ce métier, les différents postes pouvant être occupés (opérationnels ou sédentaires), les différentes filières, les modalités d’avancement, problématiques liées à l’aptitude professionnelle et les modalités de reconversion notamment.
Pourtant, il est essentiel d’aborder ces questions dès le stade de l’expertise pour permettre dans un second temps une indemnisation de toutes les conséquences de l’accident sur la sphère professionnelle également.
Comment se calcule l’indemnisation ?
Contrairement aux idées reçues, l’évaluation du préjudice des victimes n’intervient pas sur la base de barèmes. Chaque évaluation doit être individualisée pour permettre l’évaluation la plus juste et la plus complète possible du préjudice au regard de la seule situation de la victime.
La technique d’évaluation est très complexe et nécessite une vigilance particulière pour l’évaluation de chaque poste de préjudice. Le rapport d’expertise fixant les évaluations médico-légales des postes de préjudice de la victime constitue l’outil de base pour chiffrer le montant de l’indemnisation mais pas que !
Le chiffrage de chaque poste de préjudice implique également de constituer un dossier complet justifiant chaque demande indemnitaire.
FOCUS : Au titre de la perte de revenus, le sapeur-pompier peut parfaitement solliciter une indemnisation complémentaire au titre de la perte d’indemnités liée à l’arrêt (ou la suspension) de l’activité de pompier volontaire. Une indemnisation peut aussi être envisagée en cas de perte d’aptitude à servir en service incendie notamment.
Il est vivement conseillé aux victimes d’être accompagnées d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel pour permettre l’établissement d’un chiffrage complet et structuré des différents postes de préjudice.
Des discussions peuvent ensuite intervenir avec la compagnie d’assurance (ou le Fonds de Garantie) pour tenter de trouver un accord sur le montant de l’indemnisation. A défaut d’accord, le chiffrage des préjudices intervient dans un cadre judiciaire.
Mes proches ont-il droit à une indemnisation ?
Les proches d’une victime blessée ou décédée peuvent prétendre à l’indemnisation de leurs préjudices. La notion de victime indirecte est entendue au sens large dès lors qu’il existe une proximité ou un lien affectif avec la victime directe (ex conjoint avec ou sans lien juridique, enfants, parents, frères et sœurs, oncles et tantes, grands-parents…).
La nomenclature Dinthilac liste les préjudices des victimes indirectes : patrimoniaux (frais d’obsèques, pertes de revenus et frais divers) et extrapatrimoniaux (préjudice d’affection, préjudice d’accompagnement et préjudice patrimonial exceptionnel).
Une campagne de sensibilisation chez les sapeurs-pompiers
La Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France et l’équipe sportive Team 18 sapeurs-pompiers, organisent actuellement la « Campagne nationale #Prudencemoto ».
Rendez-vous ICI pour prendre connaissance de cette campagne.
Crédits vidéos : MNSPF et Team 18 – hébergement sur YouYube
Partenaires : SDIS 72, SDIS 78, AutomobileClub de l’Ouest, StudioBox
Pour conclure…
Face à la complexité des procédures d’indemnisation, les victimes — et tout particulièrement les sapeurs-pompiers — doivent faire preuve d’une vigilance constante, s’entourer de professionnels compétents et ne jamais sous-estimer l’impact d’un accident sur l’ensemble de leur vie, y compris leur engagement opérationnel.
Connaître ses droits, anticiper les étapes clés et parvenir à une évaluation juste de ses préjudices, c’est aussi une manière de préserver sa dignité et de faire valoir la reconnaissance due à celles et ceux qui s’engagent pour les autres.
Cet article a été rédigé dans le cadre d’un partenariat – publireportage – entre Carine Haddad du Cabinet NP et RESCUE18.

Sources :
– Observatoire national interministériel de la sécurité routière
– Etude « Panorama 2025 » par Relyens
– Cabinet NP
– DGSCGC
– MNSPF
– Facebook Team 18 + YouTube
– Image d’illustration by fsHH via pixabay libre de droit via WordPress






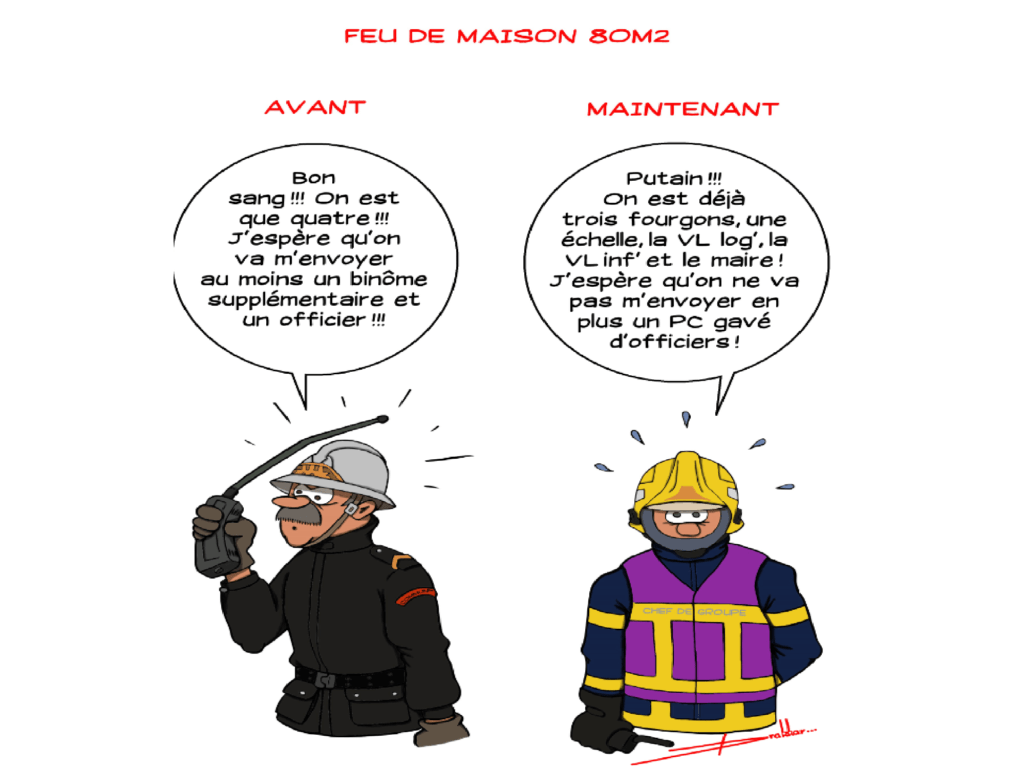


 Nos partenaires
Nos partenaires